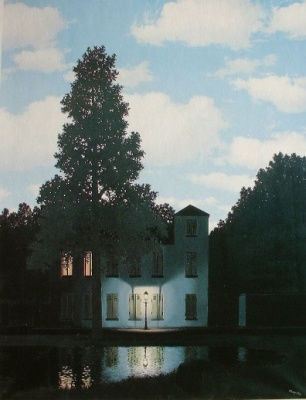période Kieslowski. je regarde La double vie de Véronique : c’est comme entrer dans un rêve dont la forme et la couleur ne me trahiront pas. d’une certaine façon, la question du destin qui sous-tend le film, et plus encore la métaphore d’un monde en spectacle de marionnettes, me touchent peu : questions essentielles, que balayent l’assurance de l’image et la beauté fulgurante d’Irène Jacob. cela dit, j’aime passionnément cette scène de la confrontation entre Véronique et le marionnettiste : il veut tester la validité d’une scène qu’il souhaite écrire dans son roman ; elle vit l’amour et l’émerveillement de la rencontre. comment dès lors combler l’écart ?
l’écart premier est entre soi et soi… voir son propre double, me crie M au téléphone par dessus le fracas des roues d’un train, c’est l’annonce de la fin proche ! je pense : doppelgänger, fantômes, traces, mimétique et archi-écriture (rien que ça). j’ai en tête l’adaptation que Louis Malle a fait de William Wilson de Poe, avec Alain Delon. il y a du double aussi chez Buñuel : le même rôle partagé par deux actrices dans Cet obscur objet du désir (lequel est également une adaptation littéraire, de La femme et le pantin de Pierre Louÿs). j’égrène les images. M renchérit : et Mulholland Drive ?
à la vérité, c’est un court texte de Cortázar que je suis allée chercher dans ma bibliothèque : j’ai toujours été fascinée par le récit en simili journal intime de La lointaine, dans le recueil Les armes secrètes (où l’on trouve aussi Les fils de la Vierge qui a inspiré Antonioni pour son Blow-up). par le biais du double Cortázar pose l’inquiétante question du soi : qui suis-je, qui parle, qui rêve en moi ou par qui suis-je rêvée ? – un soi féminin qui s’énonce comme sujet et objet, en déchirure.
« Parfois je sais qu’elle a froid, qu’elle souffre, qu’on la bat. Et je ne peux que la haïr de toutes mes forces, détester les mains qui la jettent par terre et la détester elle aussi, parce qu’on la bat, parce que c’est moi et qu’on la bat. (…) C’est la part de moi que l’on n’aime pas, et comment ne pas être déchirée lorsque je sens qu’on me bat ou que la neige entre dans mes souliers, alors que Luis-Maria danse avec moi, que sa main sur ma taille m’envahit comme la chaleur de midi, ou le goût des oranges amères, ou la vibration des bambous dans le vent, et elle on la bat et je ne peux pas le supporter plus longtemps et je suis obligée de dire à Luis-Maria que je ne me sens pas bien, que c’est l’humidité, l’humidité de cette neige que je ne sens pas, que je ne sens pas et qui entre dans mes souliers ».
Julio Cortázar, La lointaine, in Les armes secrètes, traduction de Laure Guille-Bataillon, Gallimard, 1963, p.95.
contemporain de Cortázar c’est aussi Pieyre de Mandiargues qui dessine – à sa façon, plus dure, érotique, violente, magnifique – le double féminin dans plusieurs courts textes dont mon préféré, certainement, est Feu de braise. sans doute il n’est pas anodin que, dédicaçant toujours ses textes, Mandiargues ait fait don de celui-ci à Pauline Réage… contrairement à Kieslowski qui évite soigneusement la lecture du tout onirique et se maintient par le bousculement du montage dans une sorte d’indécidable, on retrouve chez Mandiargues quelque chose de plus ancestral, plus grec, une résolution dans le sang, où Eros et Thanatos peut être figurent le tout premier dédoublement…